Les artistes longtemps au service du pouvoir
«~La musique est l’arme du futur. Lorsque je serai président, toute l’Afrique dansera au son de ma musique~», affirmait un jour Fela Anikulapo Kuti. Ses funérailles à Ikeja (Lagos), le 12 août 1997, qui attirèrent selon certaines estimations un million de personnes dont bon nombre de dignitaires du régime qui le combattirent férocement, démontrent à quel point la parole chantée possède une force unique sur le continent africain. Fascinés par ce pouvoir, les dirigeants continentaux ont donc souvent préféré s’attacher les artistes plutôt que se les aliéner. On ne peut oublier le lien étroit entretenu par des leaders tels que Nkwame Nkrumah ou Sekou Touré avec les musiciens qui firent de la musique le fer de lance de l’identité nationale : le Bembeya Jazz dont les musiciens étaient, comme tous les artistes guinéens, fonctionnaires du régime, accompagnait le président dans ses voyages officiels et chantait la gloire du régime.
Cette inféodation des artistes au pouvoir a été très marquée au Zaïre . «~A part Kabasélé et moi que l’on traitait de « Katangais » à cause de mon titre « Pazo por revolution » qui encourageait les gens à prendre leur distance par rapport au pouvoir et qui fut interdit d’antenne pendant vingt cinq ans, l’ensemble des artistes Zairois ont tous été au service du régime mobutiste~», clame Bovick Shamar. La critique à l’égard du pouvoir, avec le titre Mutukar Munene Ekangi Nzele de Koffi Olomide (un gros camion bloque la route et les petites voitures ne peuvent passer) ne vint que très tard (mai 1997).
Les Ivoiriens ne furent pas non plus en reste. Jean Baptiste Yao chantait le célèbre « Merci Monsieur le président » en hommage à Houphouët Boigny, Amédée Pierre s’affirmait comme un artiste de cour, Allah Thérèse vantait dans son titre « Cote d’Ivoire Anouanze » tout l’héritage positif du leader sans oublier Alpha Blondy et son mémorable Jah Houphouët qui hissait le président au rang de divinité. Il aura fallu attendre 1991 et les manifestations étudiantes pour qu’une nouvelle génération, les chanteurs de zouglou (Les Parents du Campus, Shuken Pat, CRS Danger public, Sur Choc), adopte une attitude critique à l’égard du pouvoir.
Combat refuge et critiques larvées
Moins dangereuse bien que très légitime (solidarité avec des frères noirs, mise en accusation d’un régime scélérat), la dénonciation contre l’apartheid est donc apparue pour beaucoup comme la voie royale de la contestation politique avec peu de risques de leur porter un préjudice direct. Il est vrai que la lutte menée par les artistes sud-africains s’est longtemps révélée comme un modèle du genre avec les mémorables interventions de Myriam Makeba aux Nations Unies, et à la fin des années 80, la création de la SAMA (South African Music Alliance), une association proche de l’UDF (Union Democratic Front) regroupant 250 artistes, des producteurs, des avocats pour défendre les artistes persécutés par le régime et possédant meme un complexe de studios d’enregistrement, Mega Music. A domicile, les critiques étaient plus larvées: dénonciation anonyme de la corruption des dirigeants comme le titre Xalis du Sénégalais Idrissa Diop ou le tube Ada ma roumen des Marocains Lem Chaheb. Il est vrai que les allusions plus directes comme celle du Togolais Ouyi Tassaen, journaliste – poète qui évoquait à mots couverts le dictateur Eyadema – « un chef qui n’a pu trouver un rocher et pour royaume, un coin dans le maquis – (le leader possède un bunker dans la banlieue de Lomé) valut à l’artiste quelques années de prison et le poussa à renoncer à la chanson. D’autres payèrent de leur vie leur engagement affirmé : le Congolais Franklin Boukaka fut exécuté pour son soutien à Marien Ngouabi, Matoub Lounès fut assassiné pour sa dénonciation de l’oppression exercée contre la minorité kabyle en Algérie.
Artistes et démocraties naissantes
Aujourd’hui, l’avancée des démocraties en Afrique de l’Ouest a provoqué la mobilisation d’un certain nombre d’artistes décidés à jouer un rôle dans les bouleversements que vivent leurs pays respectifs. Ainsi, Salif Keita a fait une apparition très remarquée à Bamako en Avril 1992 donnant trois concerts dans un stade bondé à craquer juste avant le premier tour des élections qui devaient porter Alpha Oumar Konaré au pouvoir : il n’avait pas joué dans son pays depuis le coup d’Etat de Moussa Traoré en 1974.
Thomas Mapfumo : un modèle d’indépendance
Mais participer au processus démocratique ne suffit pas, il faut encore veiller à son maintien et faire de la musique une arme de vigilance. Thomas Mapfumo, le père du chimurenga, une musique symbole de la lutte de libération que menèrent les Zimbabwéens contre le pouvoir blanc de Ian Smith (ex-Rhodésie du Sud), aurait pu en 1980, à l’indépendance, devenir un artiste officiel. Il a choisi de rester à distance du pouvoir, critiquant âprement les erreurs du gouvernement de Robert Mugabe. Un modèle à suivre…
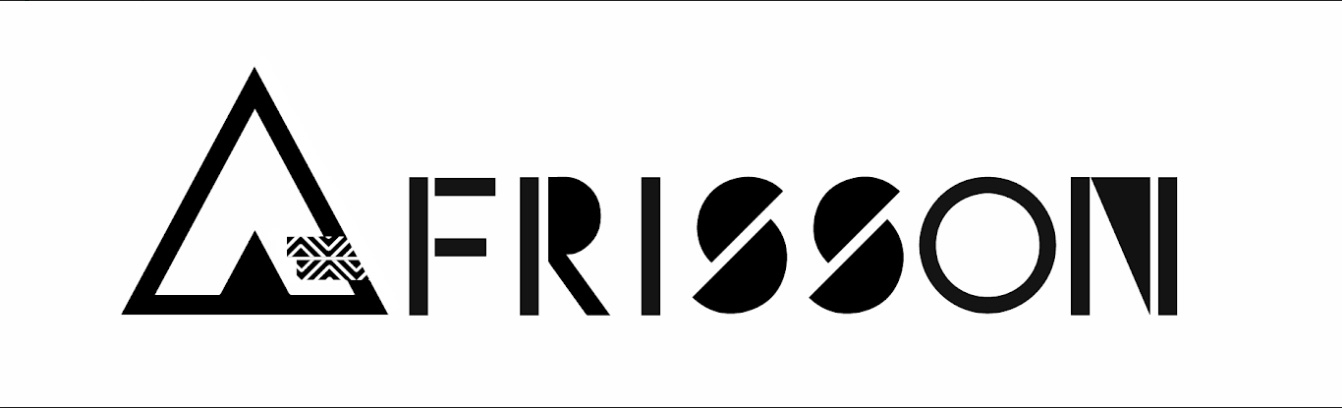



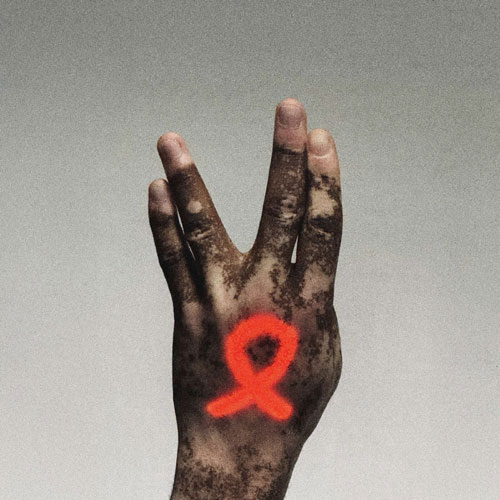



Laissez un commentaire
Vous devez être logged in pour poster un commentaire.