Sur l’île de La Réunion, et après la Seconde Guerre mondiale, le maloya était quelque peu désuet. Et c’est à partir de la fin des années 1950 que le Parti communiste réunionnais (PCR) a repris le maloya pour animer ses réunions politiques. Cherchant à mettre en valeur la culture créole, le PCR qui revendiquait l’autonomie politique de l’île, produisit les premiers disques de maloya. C’est comme ça que les Réunionnais ont connu les débuts de Firmin Viry ou bien de Simon Lagarrigue. La musique des esclaves devient alors un chant social. Les textes sont modifiés et politisés, revendiquant l’autonomie de l’île. Le maloya sera alors interdit jusqu’en 1981.
C’est depuis 1981 avec la naissance des radios libres et la reconnaissance des identités régionales voulue par le ministre de la Culture, Jack Lang, que le maloya fait partie intégrante de l’identité réunionnaise, symbolisée par les adeptes d’un maloya authentique et acoustique comme Firmin Viry et Granmoun Lélé.
Une nouvelle vague représentée par Danyel Waro, Lo Rwa Kaf, ou Ti Fock, sont depuis considérés comme les référents du genre, leur musique servant de source d’inspiration à nombre d’autres groupes : Mélanz Nasyon, Kiltir, Salem Tradition… Dans les années 1990/2000, la Réunion est traversée un courant plus électrique avec Ziskakan.
Décidés à revaloriser leurs racines africaines longtemps niées par un modèle privilégiant l’héritage européen, les joueurs de maloya n’en rejettent pas pour autant leur identité métisse. « Ma mère était black et mon père chinois. Mon île est comme ça, métissée », affirme Ti Fock tandis que Danyel Waro a intégré à son maloya les musiques traditionnelles indiennes véhiculées par le réseau des temples bhouddistes. Un des premiers à tenter de renouer avec les racines profondes du maloya fut le chanteur et guitariste aujourd’hui disparu Alain Peters.
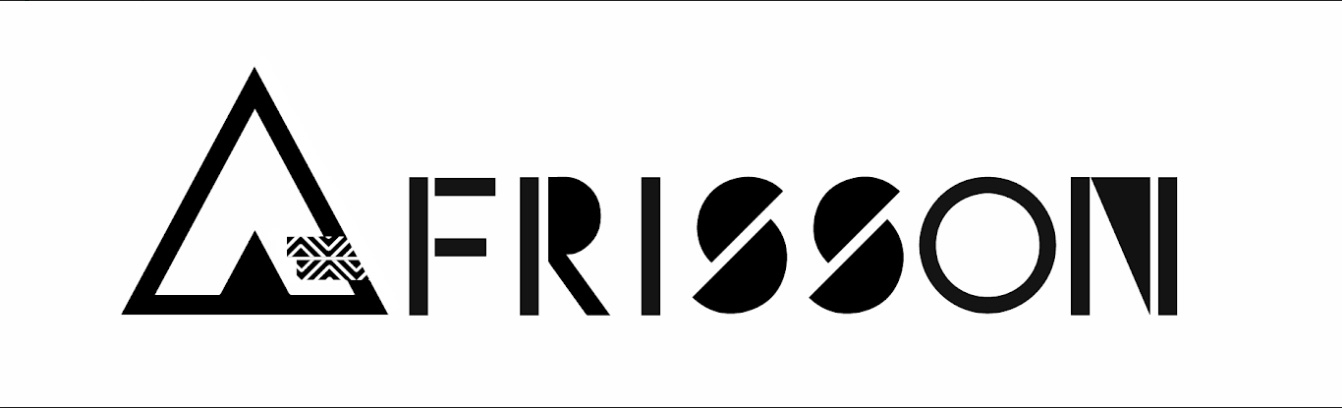
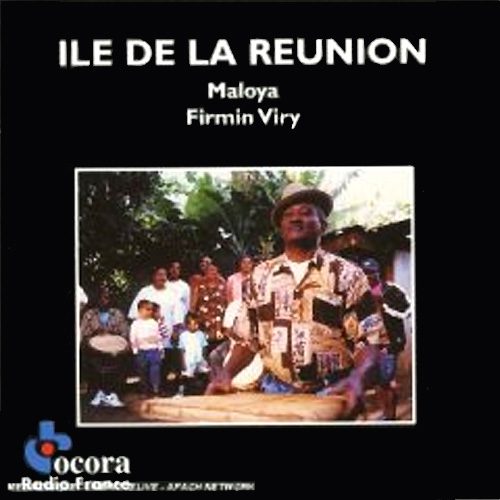

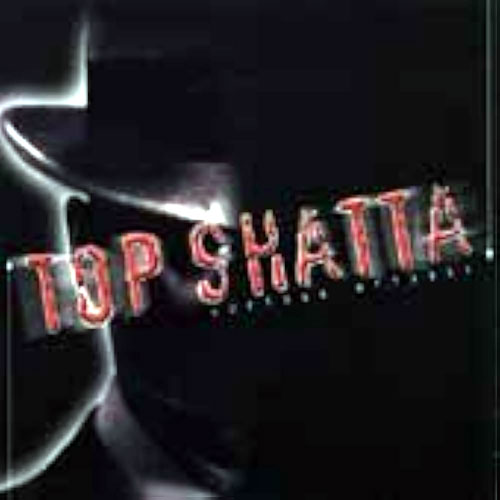

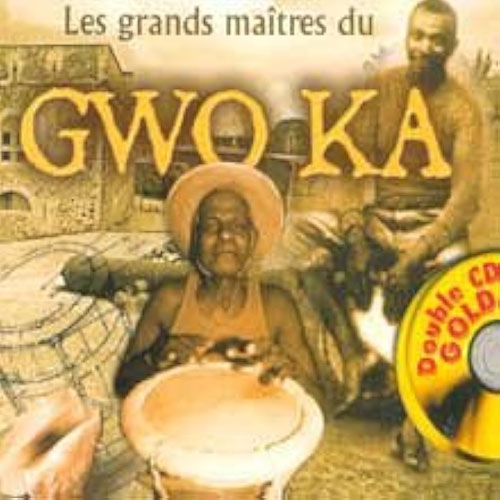

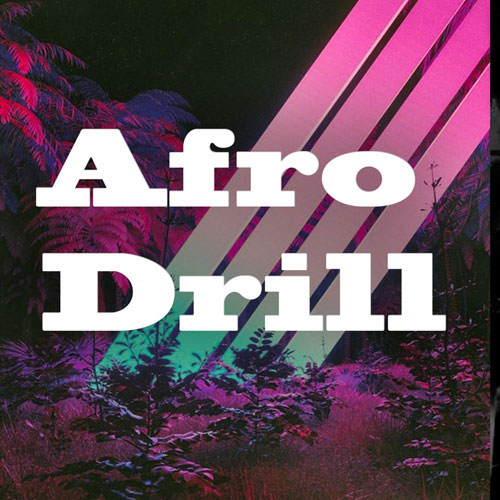
Laissez un commentaire
Vous devez être logged in pour poster un commentaire.