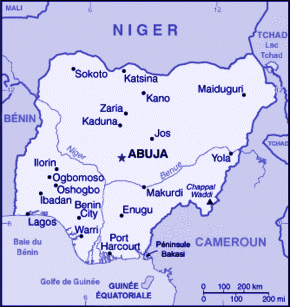
Présentation générale
Comme ses voisins (le Liberia, la Sierra Leone et le Ghana), le Nigeria formé des peuples Ibos, Haoussas et Yorubas, vit au début du XXe siècle le retour des esclaves libérés des Caraïbes et d’Amérique du Nord. Ceux-ci contribueront au fort métissage de la scène musicale locale. A Lagos, la musique tient depuis le début du siècle une place de premier plan : les guitares sont courantes et les phonographes présents en grand nombre dans la ville diffusent dans les maisons et les bars à bière les disques d’importation : musiques cubaine et hawaïenne, country et ballroom anglais.
Drum And Fife Bands, Dance Band, Guitar Band
Dans les années 1930/1940, les premières formations de « Drum And Fife Bands » préparent l’avènement du highlife. Le New Bethel School Band fait son apparition à Onitsha, à l’est du pays. Jouant une fusion de musiques afro-américaines et européennes, ce groupe prépare l’arrivée dans les années 1930/1940 des orchestres de cuivres mais aussi des groupes de guitares acoustiques annonciateurs du versant “guitar-band” ou ”blues ibo” du highlife. Le représentant le plus charismatique du highlife nigérian version “dance band” reste sans contexte Bobby Benson. Cet artiste né en 1921 dans l’ouest du pays est tour à tour tailleur, boxeur et marin avant d’opter pour la carrière musicale en 1947. Danseur, chanteur et “showman” accompli, il s’affirme comme un instrumentiste complet pouvant jouer de la guitare, de la batterie, de la contrebasse, du saxophone et même du piano. Fan de calypso et de jazz, il danse le boogie et donne en compagnie de sa femme, danseuse, des spectacles ”décoiffants” : “The Bobby and Cassandra Shows”. Déguisé d’un pantalon et d’un frac et grimé de blanc sur le pourtour des yeux et des lèvres, il imite les comédiens noirs américains des “Slapsticks Comedies”. Dans le milieu des élites consommatrices de jazz, de valse et de tango, c’est le choc. Son look fait référence aux comédies populaires à l‘usage de la “domesticité” tandis que son style musical qui va d’un swing épicé de samba et de calypso à des versants plus africains intégrant kokoma et juju crée un malaise au sein de la jet-set de Lagos.
Blues Ibo, igbo highlife
Joué essentiellement dans l’est du Nigeria, le blues ibo ou igbo blues est une version du igbo highlife. Ce style prend des accents bluesy sous les doigts experts des guitaristes Ibos surnommés les « Ibo Minstrels ». Il évolue tout au long des décennies d’avant-guerre pour exploser réellement dans les années 1960/1970 avec des artistes comme Chief Akunwata Ozoemena Nsugbe, Prince Morocco Maduka and His Minstrels et Imo Brothers International Band. D’autres musiciens dont Celestine Ukwu mais surtout Chief Stephen Osita Osadebe aka Stephen Osadebe contribuent à maintenir le genre jusque dans les années 1980/1990. Ce dernier, fondateur en 1959 de Nigeria Sound Makers International, s’impose par un jeu de guitare blues et reste fidèle à ce style même quand la vague « Nkow-krikwo », un highlife aux parfums rumba congolaise, tente une percée au Nigeria.
Highlife et rumba
Dans les années 1950, le highlife rencontre la juju music dans un style baptisée « toye ». Diffusée par la puissante Radio Brazza (Congo), la rumba congolaise conquiert le Nigeria dans les années 1960 et officialise sa rencontre avec le highlife en 1976, date de sortie du tube continental « Sweet Mother » de Prince Nico Mbarga, auteur-compositeur et interprète camerounais, né au Nigeria d’un père camerounais et d’une mère nigériane.
La juju music
Parallèlement au succès du highlife, le pays amorce, dans les années 40/50, sa propre mutation musicale et identitaire développant divers courants contemporains dont la juju music initiée dès les années 20 par des guitaristes de palm wine music (musique de vin de palme). Popularisée par I.K. Dairo puis par le roi du « Synchro System » King Sunny Ade, son explosion dans les années 1970 est favorisée par deux évènements fondamentaux : la guerre du Biafra (1967-1970) marquée par le massacre et la défaite des Ibos qui provoque la fuite de nombreux musiciens de highlife vers l’est du pays ou à l’étranger et le boom pétrolier qui voit fleurir studios et usines de pressage.
Afro-beat
Dans les années 1970/1980, l’afro-beat de Fela Anikulapo Kuti et du batteur Tony Allen marque de sa profonde empreinte la scène musicale nationale. Efficace, martelé comme le pouls d’un pays, le Nigeria, vivant la violence du post-colonialisme, de la dictature et de la corruption, l’afro-beat est un symbole fort de la musique comme « arme du futur », une expression du créateur de ce genre nigérian, Fela Anikulapo Kuti. Lancé en 1967 à Lagos, l’afro-beat est un courant musical qui se veut panafricain. Fusion de juju, de highlife, de jazz et de soul, il se caractérise surtout par la longueur des morceaux pouvant durer jusqu’à trente minutes, soutenus par une rythmique basse obsédante, des chœurs féminins et une section de cuivres mettant en exergue des solos de sax et de piano explosifs. En 1970, Fela ouvre un club le Shrine (le “temple” ou le “sanctuaire” en anglais) qui devient le haut lieu de l’afro-beat. C’est dans ce lieu que sont créés les tubes du genre comme « Zombie », « Lady Shakara », et « No agreement ».
Les héritiers de l’afro-beat
Véritable mouvement de conscience collective qui a marqué plusieurs générations, l’afro-beat est adopté, dès sa création, par de nombreux artistes apportant chacun sa couleur, dont ses fils Femi et Seun Kuti, Gaspar Lawal, Bisade Ologunde aka Lagbaja ou encore Ghetto Blaster, un groupe composé de Willy NFor (basse, lead vocal), Kiala Nzavotunga (guitare), Chief Udoh Essiet (percussions), Frankie Ntohsong Dosan (claviers), Avom Archibonmg aka Ringo (batterie), Féfé Priso (saxophone alto), Betty Ayaba « Ahlin » (voix, chœurs) et Stefan Mikhaël Blaëss (guitare). Suivront bien d’autres artistes et groupes au-delà des frontières nigérianes…
Reggae
Propulsé sur la scène internationale dans les années 1980, le reggae jamaïcain est à la même période joué par des artistes nigérians comme Sonny Okosun, Ras Kimono et Majek Fashek qui lui donnent des colorations nationales. Pourtant, l’impact du reggae reste encore modeste au regard des grands courants urbains que sont la juju, l’afro-beat et surtout de la fuji qui s’est offert à la fin des années 1980 la moitié du marché du disque nigérian.
Fuji Music
Apanage des musulmans Yoruba, la fuji music (fuji moderne) est née en 1965 au Nigeria, baptisée ainsi par Sikuru Ayinde Barrister en référence au mont japonais Fuji-Yama symbolisant l’amour, la paix et l’harmonie. Synthèse de la culture arabe préislamique et des traditions yorubas, fortement influencée dans sa structure traditionnelle par la guerre sainte fulani (peule) entreprise au début du XIXe siècle par Ousmane Dan Fodio qui provoqua la réislamisation du sud-ouest du pays, la fuji est considérée comme une musique avant tout musulmane et populaire… Prenant progressivement le pas sur la juju music dans la communauté musulmane yoruba de Lagos, la fuji est réellement devenue le « phénomène social des années 1990 ». Transcendant les clivages religieux et ethniques du Nigeria pour devenir une musique des boîtes branchées de Lagos, elle s’exporte en Occident, popularisée par des artistes comme Sikuru Ayinde Barrister, Kollington Ayinla et Wasiu Barrister, suivis de Sunny T., Abass Aknade Obasere, Adewale Ayuba et Adepoju Lanrewaju surnommé « le roi de l’ewé ».
Les années 1990 : folk, pop, soul, rap
Les années 1990 seront marquées par deux phénomènes majeurs : le succès du folk, de la pop, de la soul, du rap et l’explosion de la fuji sur le marché national. Provoquée par deux évènements clés : l’installation du batteur Ginger Baker à Lagos et le lancement d’un projet avorté de studio dans la capitale nigériane par Paul Mc Cartney, le succès de la pop et de la soul font d’Otis Redding, Wilson Picket, Carlos Santana puis Lionel Richie, Donna Summer et Michael Jackson les stars les plus écoutées de cette génération « métisse », dont Sade Adu, Keziah Jones, Féfé, Ayo, Asa (Asha)…
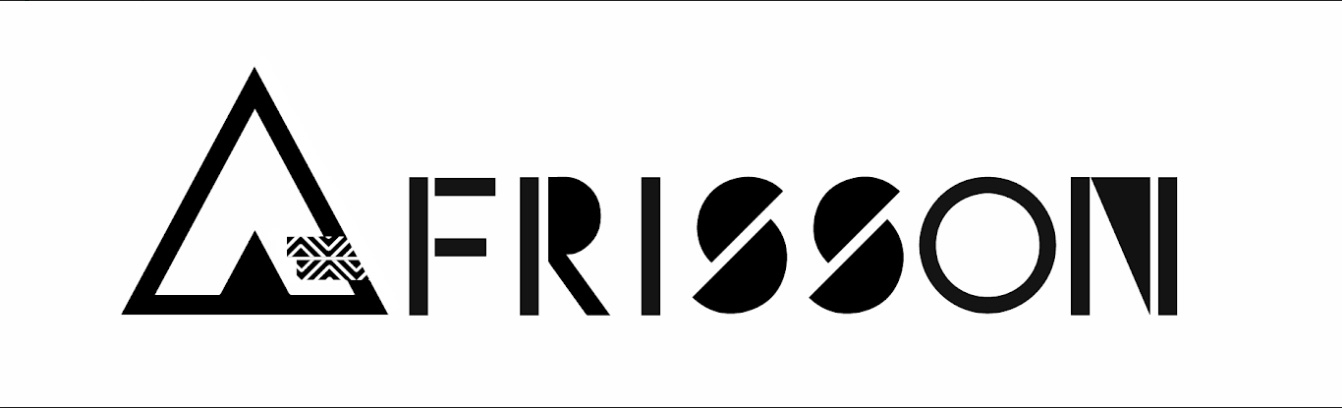

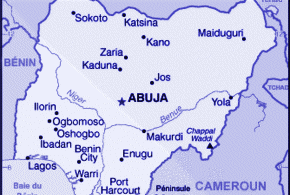

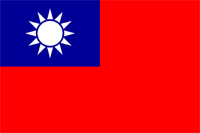
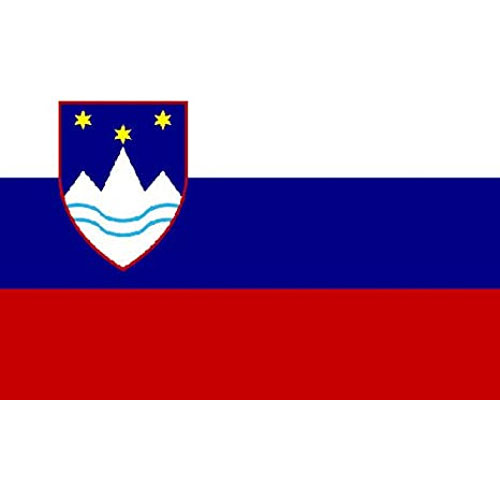



Laissez un commentaire
Vous devez être logged in pour poster un commentaire.